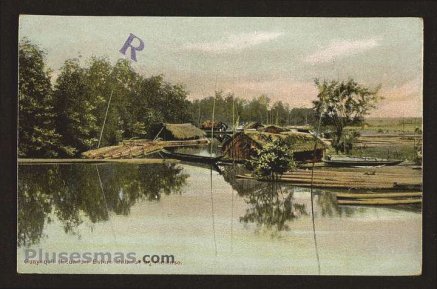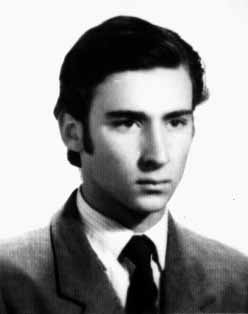Noir Equateur
Publié le
Neuf très beaux textes réalistes, sociaux et poétiques de l’Équateur des années 1930.
x
Publié en 2008 à l’Arbre Vengeur, ce recueil supervisé par Robert Amutio (qui a traduit certaines des nouvelles encore inédites en français, pour les ajouter à celles déjà traduites par Eudes Labrusse, et à celles travaillées pour l’occasion par Denis Amutio et Catherine Echezarreta) présente en neuf textes la quintessence de l’œuvre en forme courte de l’écrivain équatorien José de la Cuadra, produite entre 1931 et 1938.
x
Membre du "groupe de Guayaquil", José de la Cuadra est en général considéré comme l’un des pères de la littérature équatorienne moderne, et comme l’un des inspirateurs décisifs du renouveau de la littérature sud-américaine des années 1950 et 1960, parfois abusivement résumé sous le terme de "réalisme magique".
x
Pas de magie ou de fantastique chez de la Cuadra : chasseurs de caïmans, endurcis et obsessionnels, latifundiaires indécents et madrés, simples d’esprit adultérins et néanmoins rusés, voleurs de bétail forts en gueule, en plaisir et en générosité, femmes de fer gérant leur vie d’un poing d’acier sous l’ombre portée de la pire superstition, les protagonistes de ces nouvelles portent sur chaque centimètre de leur chair la marque d’une condition sociale assignée, dans une nation particulièrement imperméable aux mouvements, où la pauvreté menace alors sans cesse, où l’oppression permanente, si elle provoque de temps à autre quelque soulèvement, est le plus souvent noyée dans l’acceptation d’une certaine fatalité, le rire, le chant, la danse, le sexe et l’alcool.
x
Un réalisme cru, certainement, qui se nimbe toutefois au détour de bien des phrases d’un étrange halo poétique, surgi du quotidien, du décor, de la joie de vivre dans l’adversité, et qui explique encore magnifiquement, soixante-dix ans plus tard, à partir de ces campagnes reculées environnant pourtant la gigantesque ville portuaire de Guayaquil, une bonne partie de l’Équateur contemporain.
x
" "Si nous n’avions pas de légendes, il faudrait les inventer", dit José de la Cuadra, qui ajoute que cette dimension poétique et mythique est la base nécessaire de la revendication politique d’une identité montuvia jusqu’alors caricaturée et trahie. De cette revendication, qui fait appel à l’anthropologie, à la sociologie, et parcourt l’ensemble des textes, témoignent, par exemple, les récits qui se présentent comme des vies de hors-la-loi et font l’éloge du "crime social" que l’injustice pousse à commettre. C’est ce panthéisme à la fois brutal et poétique sur lequel passe un souffle politique que j’ai voulu donner à lire" (Préface de Robert Amutio)
x
"Pita et Vizuete étaient des chasseurs professionnels de caïmans. Ils vouaient à leur métier un amour pareil à celui que l’on pourrait vouer à une religion cruelle et sauvage, mais bienveillante avec ses fidèles. Pour ces hommes, le prédateur vert sombre des fleuves, le caïman des chaudes eaux tropicales, n’était pas un vulgaire gibier. C’était un ennemi certes rusé, en dépit de sa réputation de brute impulsive, mais également courageux. La chasse au caïman était pour eux comme une course de taureaux pour un torero : tout un art qu’ils jugeaient digne et noble, et qui, de plus, leur permettait de vivre." ("Guásinton, le seigneur du fleuve")
x
"C’était arrivé justement le jour où le patron Jiménez leur avait augmenté le salaire mensuel. Ah ! le patron Jiménez, si charitable, qui leur donnait argent et logement rien que pour qu’ils soient là, dans ce coin de la jungle ! (La vérité, c’est que les gens affirmaient que le propriétaire de l’hacienda, rien que parce qu’ils habitaient sur ces terres en son nom, allait devenir, au bout de quelques années, propriétaire d’une énorme partie de la montagne environnante. La vérité, c’est qu’on assurait aussi que Jiménez avait été l’homme de ña Nicolasa et que maintenant il engraissait pour son lit la fille, Refugio. Mais ça, c’était sûrement les mauvaises langues…)" ("Terres chaudes")
x
"Au milieu de l’après-midi, Juan Quishpe arriva avec son convoi de bêtes de somme, des mules. Le jeune garçon était fatigué, plus que les bêtes. Il avait chaud. L’air épais et brûlant l’étouffait. À ce moment précis, il aurait aimé se trouver sur les hauts plateaux désertiques et froids, où les vents violents coupaient sa peau comme de minuscules morceaux de verre. Il regrettait les montagnes difficiles, aux chemins pentus, où chaque pas se transforme en un prodige d’équilibre. Ici le sentier était plat, large, sûr… mais il ne pouvait pas respirer… Chaque bouffée qui pénétrait dans sa poitrine était comme une gorgée d’eau bouillante. Il transpirait énormément. Son corps baignait dans un liquide tiède, abondant, qui ne le rafraîchissait même pas. Les mules aussi… Leurs robes mouillées par la sueur brillaient, luisantes et trempées… Juan Quishpe les regardait avancer… Elles semblaient avoir perdu leur rythme de marche. Elles allaient légères, faisaient résonner leurs sabots. Elles s’arrêtaient brusquement. Puis reprenaient un trot saccadé. Faisaient des faux-pas. Tombaient. Se relevaient. Paraissaient désorientées en terrain plat." ("Sang expiatoire")
x
"Ils mangeaient, tandis que les ombres s’étendaient sur la campagne, et que le soleil se noyait – rouge et vert au loin – entre les profonds marécages où des sauriens affamés le dévoreront. La nuit, il y avait un tour de garde. Un homme armé faisait la ronde. En plus, on lâchait trois dogues furieux comme des panthères, que Máximo Gómez avait rapportés de chez son beau-frère Doile. Il y avait des dangers dans les collines rouges de Cabuyal. Les ocelots particulièrement, qui s’y étaient réfugiés en grand nombre, fuyant l’inondation. Ils étaient affamés et poussaient des hurlements de panique à tout bout de champ. Les hommes de Palo’e Balsa essayaient d’en finir avec eux. Comme il ne fallait pas gaspiller de cartouches, les ocelots étaient piégés puis achevés à la hache po ur que leur chair serve d’aliment aux chiens ; mais ceux-ci, repus, délaissaient l’abondante viande (on tuait, en effet, plusieurs ocelots par jour) et c’était les fauves qui dévoraient les restes de leurs congénères. Les hommes ne consommaient pas cette viande, non en raison de sa saveur médiocre, mais parce qu’on disait que sa consommation provoquait des flatulences." ("Palo’e Balsa – Vie et miracles de Máximo Gómez, voleur de bétail")